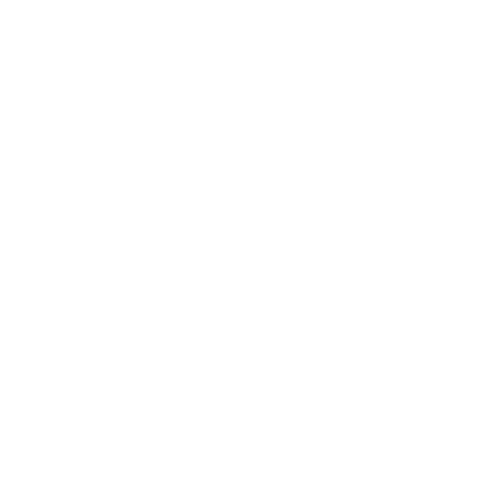09 Avr Le Trump Hazard
La mise en place de tarifs douaniers de 25% risque de remettre en cause l’équilibre des contrats déjà signés, en cours d’exécution, ou à venir.
Après l’épisode Covid19 qui a donné lieu à de nombreux débats, voici l’épisode Trump, nouvelle tempête.
Pour l’instant, le sujet concerne les droits de douane, donc la partie « prix » du contrat.
Peut-être y aura-t-il ultérieurement d’autres sujets à traiter comme l’embargo.
Il faut donc se concentrer sur la date du transfert des risques selon l’incoterm choisi par les parties.
Le vendeur augmente son prix.
L’acheteur considère qu’il y a une modification du contrat.
L’incoterm fixe la charge du paiement des droits de douane.
D’où de possibles litiges.
Mais cela pourrait concerner une rupture brutale d’un contrat par le co-contractant américain.
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt permettant au fournisseur français de saisir un tribunal français si le dommage est subi en France.
Quelles sont les références juridiques pour solutionner la question ?
- Se reporter aux Conditions Générales de Vente du vendeur et aux Conditions Générales d’Achat de l’acheteur pour déterminer la responsabilité des parties.
- Invoquer la force majeure.
Toutefois, celle-ci n’est pas définie de la même manière selon les pays, ni interprétée de manière similaire.
Par exemple, aux Etats-Unis, il est établi que le risque d’augmentation du prix en raison des tarifs douaniers ou d’actions gouvernementales ne constitue pas un cas de force majeure. Les parties engagées dans des contrats internationaux sont conscientes des risques et définissent, notamment au travers des incoterms, celle des parties qui doit supporter la charge des droits de douane.
En France, à défaut de clause de force majeure, nous pouvons appliquer la loi, c’est-à-dire l’article 1218 du Code civil. La force majeure empêche l’exécution du contrat du fait d’un évènement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation.
Au Royaume-Uni, il faut insérer une clause dans le contrat concernant la force majeure.
Par analogie on peut se référer aux principes « Unidroit » – article 7.1.7, qui reprennent les principes traditionnels de la force majeure.
- Embargo
D’une manière générale, l’embargo est considéré comme une catégorie de force majeure.
Une clause d’embargo prévue dans le contrat est parfaitement régulière. Le problème est de savoir si elle va s’appliquer compte-tenu de l’Etat qui a décidé de l’embargo et du lieu ou l’embargo doit s’exécuter.
Si une telle clause existe, elle exonère normalement la partie qui doit fournir sa prestation, de son obligation de l’exécuter.
La clause peut être libellée séparément ou l’embargo peut être prévu comme une cause de force majeure.
- L’imprévision/Hardship
L’imprévision diffère de la force majeure en ce sens qu’elle porte sur le coût supplémentaire du produit dû à un évènement extérieur mais qui n’empêche pas l’exécution du contrat.
En France, il existe un texte particulier concernant l’imprévision (article 1195 du Code civil) lorsque des circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat et qui surviennent au cours de l’exécution, rendent l’exécution dudit contrat excessivement onéreuse pour une partie. Elle entraine la renégociation des conditions et à défaut la résolution du contrat.
En droit anglais, une telle clause doit être prévue dans le contrat pour qu’elle puisse s’appliquer.
Il existe un certain nombre de références en la matière.
Les règles d’Unidroit prévoient des modèles de clauses en matière de Hardship, notamment l’article 6.2.
Il existe également des clauses de la Chambre de Commerce Internationale sous le titre « ICC Force majeure and Hardship clauses ».
- Convention de Vienne
La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises prévoit, dans ses articles 72 et 73, des dispositions concernant l’inexécution des obligations des parties, notamment dans les contrats à livraisons successives.
Il est visé les cas où l’une des parties n’exécute pas une partie essentielle de ses obligations ou si, avant la date d’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie commettra une contravention essentielle au contrat.
- Limitation de responsabilité / Clauses pénales
Dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas tout ou partie de ses obligations, il est possible de faire application des clauses de limitation de responsabilité contenues dans les conditions générales des parties.
Ces clauses de limitation de responsabilité sont valables dès lors qu’elles n’exonèrent pas l’une des parties de son obligation essentielle.
C’est ainsi que le Code civil français (article 1170) dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Les clauses pénales qui prévoient le paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation sont valables en France et prévues par l’article 1231-5 du Code civil français avec possibilité pour le juge de modérer ou d’augmenter le montant de la pénalité.
Mais en droit anglais cette notion n’existe pas et il faut se référer aux « liquidated damages » que les parties prévoient dans leur contrat.
En conclusion, les parties disposent d’un arsenal juridique leur permettant de trouver une solution amiable.
Thierry CLERC
www.tclerc-avocats.fr